Pourquoi Marx redevient capital ? (2)
popularité : 4%
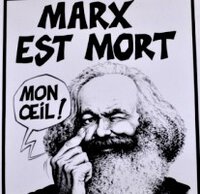
Christian Laval un des auteurs du monumental ouvrage sur Marx qui vient de paraître chez Gallimard – « Marx : prénom Karl » - et qui explique pourquoi il est nécessaire et utile de lire ou relire Marx aujourd’hui.
Crise, Grèce, État, Europe, austérité…
Marianne 2 : La crise financière de 2008 ne peut pas être vraiment comprise selon vous sans une lecture approfondie de Marx ? Pourquoi ?
Christian Laval : Je dirais que la crise ne peut être comprise dans sa profondeur et dans sa dynamique sans avoir en mémoire l’analyse que fait Marx de l’autonomie du capital sous sa forme argent par rapport à la production elle-même. Le vertige de la financiarisation, dès le milieu du XIXe siècle, était perceptible à qui savait prêter attention aux symptômes les plus graves du capitalisme et en tirer des conclusions quant à son fonctionnement. C’était le cas de Marx. Ce fut sa grandeur. Mais ce vertige de la spéculation, s’il donnait lieu régulièrement à des effondrements boursiers ou des faillites bancaires, restait tout de même sporadique. La production était le cœur de la machine à profits.
M2 : Le capitalisme financier d’aujourd’hui, c’est la spéculation devenue la loi suprême et permanente du système ?
C. L. : En effet, tout se passe comme si « l’argent pour l’argent » pouvait s’affranchir complètement de la production, comme si le « toujours plus » conduisait à se délester des usines, des travailleurs, et au fond de la société elle-même…Même les « permis de polluer » sont l’objet de la finance ! Aujourd’hui, plus personne ne sait comment sortir de cette logique infernale et destructrice. Les « solutions » avancées par les uns ou par les autres ( recapitalisation des banques privées, mini-taxe Tobin, protectionnisme, banque publique de développement de l’industrie, etc) semblent des gadgets pour enfants à côté de la grosse machinerie financière qui domine toute l’économie et met en pièces les derniers restes de la démocratie représentative.
M2 : Marx était un incorrigible optimiste. Il aurait dansé de joie en 2008 comme il l’a fait avec son ami Engels en 1857 ?
C. L. : C’est vrai ! Marx était un incorrigible optimiste ! Car il était persuadé que la révolution devait suivre de près la crise, puisque pour lui la loi de l’histoire faisait que le communisme était l’enfant, un peu bâtard certes, du capitalisme lui-même. Comment soutenir, sauf à réhabiliter la thèse de « l’effondrement final », que le communisme est inéluctable ? Bien d’autres choses peuvent sortir de la crise que la révolution. En ce sens le « marxisme » comme progressisme optimiste ne nous semble plus tenable.
M2 : La bulle du crédit, on s’en rend compte aujourd’hui, n’a pas seulement eu des effets sur les particuliers, elle a touché les États eux-mêmes, dont les finances ont été très délibérément prises en tenaille entre les baisses d’impôts et le recours aux marchés financiers ?
C. L. : C’est vrai ! Aujourd’hui, les États interviennent très activement pour sauver le système bancaire en reportant les coûts de la crise sur les chômeurs, les retraités, les salariés. Ces États apparaissent ainsi comme ces « instruments » du capitalisme dont parlait Marx. Mais s’arrêter à cela, ce serait oublier que l’État est bien plus qu’un « appareil » au service des entreprises privées et des banques. Les institutions, les dispositifs de gestion de la société, les systèmes réglementaires qui le composent produisent très activement des rapports de pouvoir, des formes d’assujettissement, des formes de pensée qui jusqu’à aujourd’hui ne coïncidaient pas intégralement avec la logique privée d’accumulation du capital. La nouveauté du néolibéralisme, c’est la co-production entre l’État et les grandes entreprises des règles de fonctionnement du capitalisme financier et des modalités d’adaptation de la société aux « contraintes » imposées par la mondialisation. L’État co-produit la mondialisation et il prétend en protéger la société. Nous assistons à une gigantesque hybridation « public-privé », qui n’est ni le dépérissement de l’État par sa dissolution dans la société ni le totalitarisme par absorption de la société dans l’État. La co-production néolibérale se traduit par un processus de fusion par le haut des oligarchies capitalistes et bureaucratiques, ce qui suppose l’homogénéisation des normes et des institutions privées et publiques à tous les étages.
M2 : Les émeutes en Grèce s’inscrivent-elles dans la déjà longue histoire des luttes contre l’emprise du capitalisme néolibéral et les plans d’ajustement structurel imposés en Europe ?
C. L. : C’est la manifestation désormais ouverte de la guerre sociale. La lecture par Marx de la lutte reste d’une évidente actualité. Mais remarquons que les évènements de ces dernières années ne correspondent pas à la mythologie d’une classe partant « à l’assaut du ciel » selon l’expression de Marx. Les salariés, les retraités et les étudiants n’aspirent à aucun ciel. Ils veulent défendre les moyens qui leur restent pour vivre et pour survivre et qui sont menacés par les politiques régressives qui veulent les en priver. Ce sont des émeutes, non des révolutions. Du moins pas encore.
La guerre sociale n’est pas d’abord venue du bas, elle n’a pas été déclenchée par un peuple révolté et assoiffé de liberté et de justice. Elle vient du haut, elle a été déclarée et elle est menée par les classes dominantes afin de réduire par tous les moyens possibles les droits sociaux et politiques conquis au XXe siècle, et ceci au nom de la compétitivité, de l’emploi, et surtout des profits. La mondialisation d’abord, et la crise qu’elle a engendrée ensuite, servent de levier pour l’emporter sur les résistances sociales et politiques. Les classes dominantes ne sont pas complètement aveugles et sourdes sur les réactions et sur les conséquences dépressives de l’austérité. Mais elles croient avoir une chance qu’elles ne doivent pas laisser passer d’en finir avec les compromis sociaux d’après guerre, lesquels correspondaient à un rapport de force à l’époque relativement favorable aux salariés. C’est tout l’enjeu de la période que nous vivons.
M2 : Que pensez-vous du couple franco-allemand ?
C.L. : Est-ce un couple ? La situation européenne n’a plus grand-chose à voir avec ce qu’elle était du temps de Marx. Ce dernier pensait les choses à peu près ainsi : l’Angleterre, c’était l’économie, la France, c’était la politique et l’Allemagne, c’était la philosophie et la science. La tâche du mouvement ouvrier était la synthèse des trois. On ne peut plus du tout raisonner stratégiquement comme Marx le faisait. L’Europe n’est plus le centre du monde et le coeur de l’histoire. De nos jours, l’Angleterre c’est plutôt la finance, l’Allemagne c’est l’industrie, et la France est d’autant plus fascinée par l’Allemagne industrielle qu’elle a largué son industrie comme l’Angleterre. Pour Marx, il y avait des puissances dominantes réactionnaires qui influençaient tout le cours de la politique européenne. La Russie tsariste et la Prusse étaient les deux piliers de la réaction. Aujourd’hui, les gouvernements d’Angleterre, d’Allemagne et de France, en dépit de leurs divergences, forment un nouveau bloc qui impose une politique brutalement déflationniste aux populations d’Europe afin de pouvoir « ajuster » les salaires et le droit du travail, c’est-à-dire réduire le « modèle social ».
M2 : Mais par là, l’Europe tend à redevenir le foyer politique central, la ligne de front principale. De l’affrontement sortira-t-il une nouvelle force sociale capable de renverser le cours des choses ?
C.L. : Contrairement à Marx, nous ne le voyons nulle part écrit comme une nécessité historique. Mais c’est une possibilité qui commence à prendre corps. Reste à savoir si le salariat et la population passeront de l’indignation à la révolution…Seule la lutte le dira.
Rédigé par Philippe Petit le 22/03/ 2012 source Marianne 2
Transmis par Linsay




Commentaires